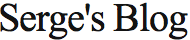On trouve parfois au bas d'un article sur Internet, perdu au milieu de centaines d'autres commentaires, l'expression parfaite d'un sentiment largement partagé, mais rarement exprimé de façon concise et élégante. Commentant un article de Libération sur la crise grecque, un certain Aloha-Cardan écrit tout haut ce que tout le monde pense tout bas :
Demandez au Sud-Coréens s'ils ne sont pas revenus à la prospérité après la crise asiatique de 98 et le régime sec imposé par le FMI. Seulement il a fallu qu'ils se retroussent les manches..
Voilà : si seulement les grecs et leurs gouvernements "retroussaient leurs manches" et faisaient preuve d'un tout petit peu de bonne volonté, on n'en serait pas là. J'aime beaucoup ce commentaire, d'abord parce qu'il est l'illustration parfaite de ce qu'exprimait H.L. Mencken : "Tout problème complexe a une solution claire, simple, et fausse", mais surtout parce que comparer la Grèce de 2010 avec la Corée de 1998 est un excellent moyen de comprendre pourquoi la "solution" proposée par la Troïka ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner.
Ma première objection, certes mineure, est que le postulat sociologique mal dissimulé dans le commentaire, reprenant les stéréotypes bien connus des asiatiques courageux et des méditérranéens paresseux n'est, en fait, pas vrai : depuis qu'on a des statistiques fiables, on observe que les grecs travaillent en moyenne certes un peu moins que les coréens, mais bien plus que tous les autres européens. Il est exact que les jeunes grecs ne travaillent pas beaucoup pour le moment, le taux de chômage des jeunes avoisinant 50% depuis 2012, mais il n'était que de 20% avant la crise, pas spectaculairement plus élevé que la moyenne de l'eurozone (16%). Soit une génération exceptionnellement paresseuse est comme par hasard née 18 ans avant le début de la crise, ce qui serait une coïncidence pour le moins surprenante, soit il y a un autre problème.
Le fait est que la Grèce a vécu au-dessus de ses moyens : entre l'adoption de l'Euro, en 2000, et la crise de 2007, le taux d'inflation en Grèce est resté de 2% supérieur à la moyenne de la zone Euro. Dit autrement : le coût de la vie, et les salaires, ont augmenté plus rapidement en Grèce que dans le reste de l'eurozone, suite à un apport massif de capitaux privés venus du reste du monde, principalement d'Europe. Il faut rappeler que durant cette période, personne n'y voyait rien d'anormal : le monde occidental était en croissance confortable, l'intégration européenne fonctionnait, les traités européens étaient vus comme garants d'une bonne gestion, certains allaient jusqu'à dire que la probabilité de crise financière était devenue extrêmement faible.
Beaucoup de gens se sont trompés. C'est fort dommage, mais cela arrive. Le résultat est que suite à la crise, les investisseurs sont devenus beaucoup plus prudents, et l'afflux de capitaux vers le sud de l'Europe, notamment la Grèce, a brutalement cessé. Celle-ci s'est donc retrouvée avec des coûts salariaux supérieurs à ce que le contexte économique international pouvait supporter. C'est là que l'on trouve l'élément déclencheur de la crise grecque, bien plus que dans la fraude fiscale ou les déficits publics : l'Espagne et l'Irlande, tous deux admirés jusqu'en 2007 pour leur bonne gestion et leurs gouvernements peu dépensiers, ont dû faire face aux mêmes difficultés.
Comment, donc, relancer la croissance quand les salaires des grecs sont considérés trop élevés par les investisseurs au regard de leur productivité ? Solution évidente : augmenter la productivité et/ou baisser les salaires. La première voie est hautement désirable, mais elle demande soit des apports de capital, ce à quoi la Grèce n'a plus droit, soit beaucoup de temps, via une meilleure éducation et des infrastructures plus efficaces, toutes des choses qui demandent des investissements publics hors d'atteinte d'un gouvernement au bord de la faillite.
Il faut donc, à court terme, que les salaires baissent. Cela peut se faire de deux façons : soit les employés acceptent, tous ensemble, de diminuer leur rémunération, soit le gouvernement dévalue la monnaie. Du point de vue d'un investisseur ou d'un client américain, cela revient exactement au même qu'un employé grec accepte de travailler pour 800€/mois plutôt que 1000€/mois (le salaire moyen en Grèce), ou que ce même employé conserve sa rémunération nominale de 1000€/mois pendant que l'euro perd 20% de sa valeur par rapport au dollar.
Un postulat essentiel de la stratégie de la Troïka est que, oui, ces deux scénarios sont exactement identiques, et que la Grèce peut sortir de l'ornière en "dévaluant en interne" : les 50% de jeunes grecs au chômage sont uniquement au chômage parce qu'ils refusent de travailler pour un salaire "juste". Si cette situation continue, ils accepteront la réalité, prendront un travail moins bien payé, ils payeront des taxes au lieu de percevoir le chômage, l'économie redémarrera et l'état grec retrouvera l'équilibre financier.
Ce scénario est intellectuellement cohérent, mais malheureusement peut-être, tout indique que ce n'est pas comme cela que le monde fonctionne. Les gens acceptent très difficilement de baisser leur salaire, même quand c'est objectivement nécessaire pour leur prospérité et celle du pays. Intuitivement, on peut le comprendre en remarquant que le coût de la vie ne peut pas baisser instantanément : les produits de consommation, l'immobilier, etc. ont tous été produits sous les anciens salaires "trop haut" et personne ne veut vendre à perte, donc la vie reste nécessairement chère sur le court terme. Simultanément, ce n'est pas rationnel pour un jeune chômeur grec d'accepter un travail qui paye moins que ses indemnités de chômage, ou à peine plus mais l'oblige à endurer des frais supplémentaires. Sur le long terme, l'ajustement est inévitable, mais il prend énormément de temps, durant lequel toute la population est moins prospère et productive qu'elle pourrait l'être. Un jeune qui commence sa carrière par cinq ans de chômage parce qu'il a le malheur d'obtenir son diplôme durant une période de crise ne récupère jamais ces années perdues. Il gagnera moins, le pays produira moins, les investissements en éducation et infrastructure nécessaires à la bonne santé économique du pays seront retardés d'autant. Même sans aborder des questions de morale ou de justice, il semble clair que cette procédure d'ajustement est grossièrement inefficace.
C'est pourtant la stratégie choisie par la Troïka. L'economiste anglais John Maynard Keynes a compris dans les années 30 que toute "dévaluation interne" est lente et inutilement douloureuse, et près d'un siècle d'études empiriques ont montré qu'il avait raison, mais les institutions européennes chargées de gérer la crise grecque font fi de ces décennies de savoir économique comme de l'expérience de ces quatre dernières années, et prétendent encore, envers et contre tout, que leur stratégie va fonctionner.
Ils se sont pourtant trompés sur toute la ligne : comparer les prédictions du FMI sur l'effet des mesures imposées à la Grèce depuis 2010 avec ce qui s'est réellement passé ferait mourir de rire si ces chiffres ne reflétaient pas un drame humain d'une ampleur colossale en termes d'espoir de carrière détruits et même de morts (la mortalité infantile en Grèce a augmenté de 43% entre 2008 et 2010), alors que les coupes dans le service public provoquent un gâchis monumental : l'île de Santorini, (soi-dit en passant une merveille de la nature, même si ce n'est pas très important ici), 15,000 habitants et 2 millions de touristes par an, héberge un hopital public entièrement équipé mais totalement vide, car les réductions de budget ne permettent pas à l'état de payer les docteurs et infirmiers qui devraient y travailler. Et après tout cela, la dette publique grecque atteint aujourd'hui 177% du PIB, contre 105% en 2008. Si tous ces sacrifices avaient rendu les finances gouvernementales saines et durables, on pourrait encore envisager parler de succès, mais c'est tout le contraire : le gouvernement grec est plus proche de la faillite qu'il n'a jamais été. Qui peut sérieusement penser que ceci est la bonne façon de gérer le pays ?
Mais revenons à la Corée : si cette approche est tellement destructrice pour la Grèce, pourquoi a-t-elle marché en Corée ? Serait-ce malgré tout parce que les coréens savent retrousser leurs manches, contrairement aux grecs ?
Non, pour plusieurs raisons. Les deux crises présentent des similarités : une bulle financière a amené un excès de capitaux étrangers vers les économies d'Asie du sud-est, et après l'éclatement de cette bulle les gouvernements locaux se sont retrouvés pratiquement en faillite. Mais la comparaison s'arrête là. La Corée n'a jamais eu à opérer une dévaluation interne : juste après la crise financière asiatique de 1997, le taux de change entre le Won et le Dollar est passé de 954 à 1404. La monnaie coréenne a perdu près d'un tiers de sa valeur en quelques mois. Bien sûr, dans une économie qui repose largement sur l'exportation, l'état peut réduire ses dépenses publiques sans grêver l'économie, dopée par une baisse d'un tiers des coûts salariaux réels.
La Grèce, par contre, ne contrôle pas sa monnaie, l'Euro. Elle n'a aucun moyen d'agir à court terme sur son économie autrement que par sa politique fiscale (les dépenses et recettes publiques), vu que sa politique monétaire est entièrement décidée par la banque centrale européenne. Et donc, quand elle réduit ses dépenses publiques, il n'y a pas d'investisseurs privés pour prendre le relai, donc l'économie se contracte, et la valeur réelle de la dette, en pourcentage de l'économie, augmente. C'est là de la théorie économique élémentaire, compréhensible pour n'importe quel étudiant dans le domaine.
La Corée s'en est mieux sortie que la Grèce parce qu'elle n'a jamais eu à faire ce que l'on demande aujourd'hui à la Grèce. Et même comme ça, l'endettement public coréen a presque triplé suite à la crise, passant de 13% du PIB à environ 30%, chiffre qui n'a pas diminué depuis. Si la Grèce pouvait tripler son endettement, elle n'aurait aucun problème, mais au lieu de partir de 13%, elle part de 100%, ce qui n'est pas inhabituel en Europe : la moyenne de la zone euro était à 64% en 2008 et atteint 95% aujourd'hui. Si on imposait à la Belgique les restrictions budgétaires que l'on impose à la Grèce, ce serait peu ou prou la même catastrophe.
Certes, les gouvernements grecs des années 90 et 2000 ont triché : ils ont maquillé leurs comptes, et caché des problèmes structurels qui auraient dû les empêcher d'adopter la monnaie unique. Mais… et alors ? Les autres membres de la zone euro sont également en faute, pour n'avoir pas examiné suffisamment attentivement les comptes grecs. Ils ont une excuse : l'euro a toujours été un projet politique, motivé par un désir d'intégration et d'union continentale que l'on peut admirer, plus que par la froide rigueur économique.
Les banques françaises et allemandes qui ont prêté de l'argent à la Grèce avant la crise ont fait un pari, pensant qu'aucun membre de la zone Euro ne ferait jamais défaut. Elles ont aidé les grecs pendant ces années, et se faisant se sont confortablement enrichies, et en soi c'est très bien. Mais tout cela nous met aujourd'hui face à un problème dont les responsabilités sont clairement partagées. Il doit être abordé comme n'importe quelle faillite d'entreprise ou n'importe quelle crise financière : pas en cherchant à punir les "responsables", certainement pas en punissant les jeunes grecs qui ne sont en rien coupables des agissements des gouvernements des années 90 pour lesquels ils n'ont jamais voté, mais en cherchant la meilleure façon de construire un avenir le plus positif possible.
À peu près la seule chose totalement indéniable à ce stade est que l'approche prônée par la Troïka ne fonctionne pas. Mais, alors, qu'est-ce qu'on fait ?
La Grèce va peut-être sortir de la zone euro, et même de l'Union Européenne. Au point où on en est, cela n'a plus rien d'un scénario inenvisageable. Il est urgent de se demander ce qu'il va se passer ensuite. Même pas pour les grecs — apparemment tout le monde s'en fout, ce ne sont de toutes façons que des tricheurs paresseux — mais au moins pour le reste de l'eurozone.
Le "Grexit" n'est une solution que pour ceux qui pensent que l'Euro marche très bien, qu'il est juste temporairement entaché par un petit pays dirigé par une succession de gouvernements irresponsables. Dès qu'on sera débarrassés de la Grèce, tout rentrera dans l'ordre. Mais ce n'est pas le cas : l'union monétaire européenne, telle qu'elle est conçue actuellement, semble condamnée à transformer des problèmes relativement mineurs (la Grèce, qui représente 2% de l'économie européenne, avait peut-être un excédent budgétaire de 3% de PIB au moment de la crise, ce qui aurait dû être parfaitement gérable) en crises insurmontables. Après la Grèce, l'Espagne aura exactement les mêmes problèmes, puis le Portugal, l'Irlande, l'Italie… On dira sans-doute que les espagnols sont paresseux et irresponsables.
Une autre crise financière offre un parallèle intéressant : le gouvernement de Puerto Rico est également en faillite, son gouverneur ayant annoncé ce dimanche que le territoire est incapable de payer ses dettes. Souvent considéré comme le "51ème état" des États-Unis, Puerto Rico ressemble un peu à la Grèce : régulièrement accusé de mauvaise gestion et de corruption, récipiendaire d'énormes investissements lucratifs pour les capitalistes américains, il est prisonnier d'une devise qu'il ne contrôle pas, et se retrouve maintenant incapable de payer ses dettes. L'administration Obama a déjà déclaré qu'elle ne payerait pas pour sauver l'île, et son statut juridique lui interdit de se déclarer en faillite, comme l'a fait entre autres la ville de Detroit.
C'est là un imbroglio juridico-fiscal peu compréhensible, et bien malin qui peut dire ce qui va se passer. Mais Puerto Rico a un avantage énorme par rapport à la Grèce : ses citoyens sont américains, et tous les américains en sont conscients. Autant la majorité des allemands, français, belges, ne voient pas pourquoi ils devraient payer pour les erreurs de la Grèce, autant cela semble tout à fait évident à la majorité des américains que le destin des portoricains est intimement lié au leur. Les États-Unis, pour tous leurs défauts, et leurs problèmes de racisme, forment une nation. L'Union Européenne, non.
S'il avait dû être évalué uniquement pour ses mérites économiques, l'Euro n'aurait jamais vu le jour. Mais il était, et reste, un projet politique : des peuples très similaires, mais qui se sont fait la guerre pendant des siècles, pourraient, devraient, se concevoir en une même nation, partageant des idéaux et un destin commun. Si ce n'est pas le cas pour le moment, cela va le devenir, et on aidera ce processus en leur faisant partager la même monnaie.
Je souscris entièrement à cet idéal. Mais l'union monétaire telle qu'elle est actuellement conçue présente de graves problèmes structurels, dont la crise grecque n'est qu'un symptome, et l'indifférence, voire l'hostilité, de l'Europe du nord face aux tribulations du peuple grec est tout sauf encourageante.
Ce qui m'inquiète le plus, à ce stade, est que la Troïka — pardon, les institutions — semble penser qu'il n'y a pas vraiment de problème structurel, que tout irait très bien si la Grèce n'avait jamais triché. Rien n'est moins vrai. C'est l'avenir même du projet européen qui se joue dans les enseignements que ses institutions tirent de la crise grecque.
 Friday, September 4, 2015 at 9:38AM
Friday, September 4, 2015 at 9:38AM